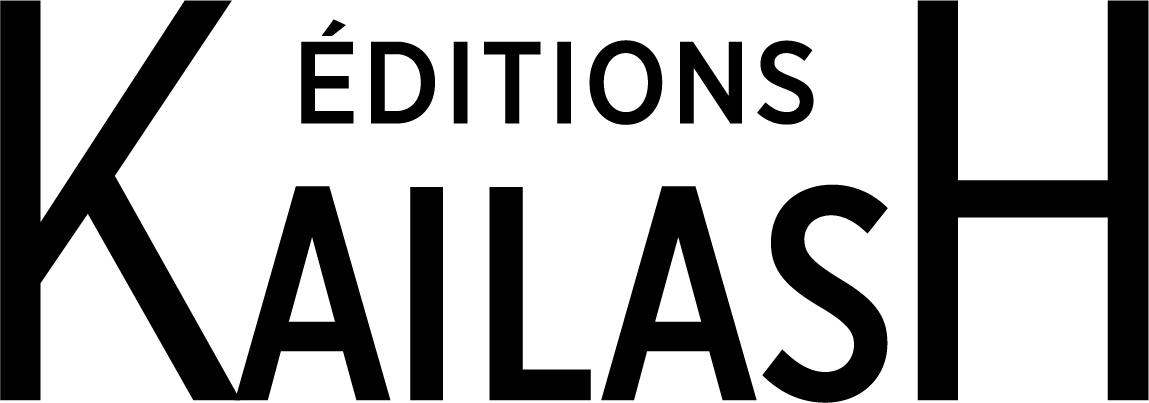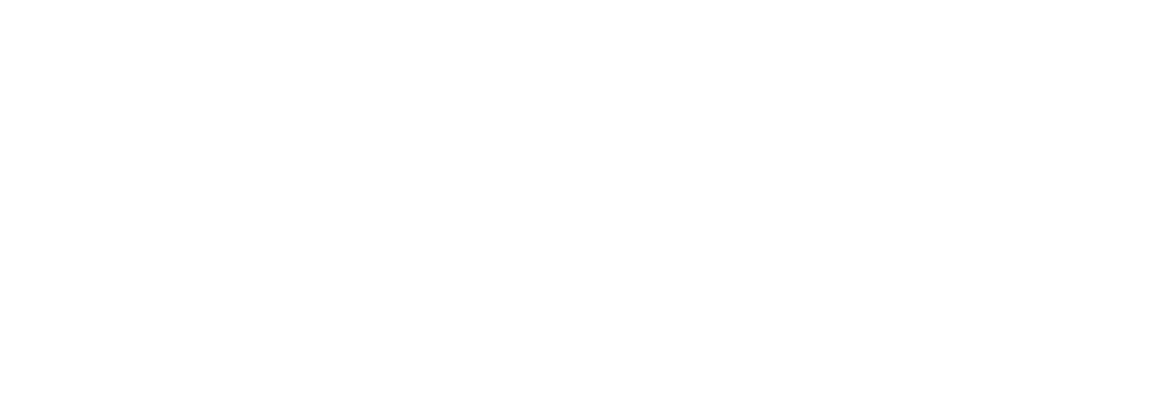• Le SCARWEATHER a été construit en 1947 par le chantier Philip and sons à Dartmouth (Grande Bretagne) pour le compte de la Trinity Corporation (équivalent de notre Service des phares et balises). Long de 42,50 m, il fait partie de la dernière série des bateaux-feux de l’après-guerre. En 1947, il est positionné sur le banc Smith Knoll, un des bancs de sable qui longent le Norfolk. Il est ensuite positionné sur les bancs Scarwearther au large de Bristol, en baie de Swansea (pays de Galles). Il prend ainsi son nom actuel. Le bateau-phare est désarmé en 1989. Il est vendu au musée de Douarnenez où il est remorqué en 1992. En 2008, la coque est repeinte et de petites réparations sont effectuées. Il est visible, mais pour des raisons de sécurité, le Scarweather n’est pas visitable.
• LE SANDETTIÉ, ou BF6 (bateau-feu no 6), est le dernier bateau-feu français à avoir été en service. Construit en 1947 et long de 47,50 m, il a d'abord été affecté au banc du Dyck en 1949. En 1978, ce banc de sable n’étant plus balisé, le BF6 est alors affecté au poste du banc du Sandettié jusqu’en 1989 et son désarmement définitif. Il est ensuite reconverti en bateau musée, classé monument historique. Il fait partie depuis 1997 de la collection à flot du Musée portuaire de Dunkerque ; ce dernier disposait également du Dyck (BF2, ex-Havre II) qui a finalement été mis en démolition en juin 2008. Classé également monument historique, il a été décommissionné en 2004.
Les seuls bateaux-phares ayant une activité sont :
• LE BATEAU PHARE
Baptisé Osprey à l'origine, il fut construit à Dartmouth (Royaume-Uni) par le Chantier Philips & Son et lancé le 24 mai 1955. Il fut un des derniers light ships (bateaux-feux) irlandais mis en service pour le compte des Commissioners of Irish Lights. Il était stationné le long des cotes irlandaises de 1955 à 1975, date de sa désaffectation. Il fut alors vendu au port de New Ross (Irlande) où, après une première transformation, il devint un dépôt de fuel à flot, puis servit de logement pour les pilotes jusqu'en 1997.
Remorqué cette année-là au Havre, le bateau arrive à Paris à la fin de l’année suivante. Il est progressivement réhabilité en équipement culturel par une association qui le baptisa Batofar en 1999. À Paris, la transformation technique est réalisée par Herskovits, Thômé & Tobie, architecte naval. Après son rachat en 2018, la structure éclairante du navire est démontée marquant le signal de son prochain transfert au Havre pour rénovation. En 2019, la nouvelle direction a ouvert une terrasse saisonnière à quai, en prélude à une réouverture du bateau, finalement dénommé Bateau Phare.
• L’IBOAT
Souvent comparé au Batofar, l’IBoat en est même le petit frère. Il été transformé en ferry pour relier l’île d’Yeu sous le nom de La Vendée, avant d’être reconverti à bordeaux en lieu culturel flottant en 2011, dans le quartier en plein renouveau du Bassin à Flot n°1. Après un mois de cale sèche pour réparations en 2019, il est revenu s’amarrer quai Armand-Lalande.
• LE ROQUEROLS
1939 Londres : le Lightship no. 94 (LV 94) construit à l’origine pour la Trinity House Lighthouse Service en 1939 fut affecté à Londres pendant la Seconde Guerre Mondiale. Il a écumé les ports anglais pour remplir sa mission jusqu’en 1990, année de sa décommission.
1998 Amsterdam : le LS 94 sert un temps de musée après des travaux de réaménagement, puis de lieu d’événements privés avec salle de conférence sous le nom de Zeeburg.
2013 Lyon : racheté par un investisseur français pour être reconverti en salle de spectacle et amarré sur le Rhône. Dans cette perspective il est renommé Razzle mais le bateau est refusé par la ville de Lyon.
2017 Marseille : il est remorqué vers le chantier naval de Marseille. Après plusieurs mois de travaux, le Razzle est amarré au port de l’Estaque. Quatre ans de réhabilitation de fond en comble auront été nécessaires pour remettre en l’état le navire qui accueille une salle de concert, un club, un restaurant et un bar terrasse installé sur le pont.
2021 Sète : le 19 février 2021, le Razzle est remorqué jusqu’à Sète où il deviendra le vaisseau amiral des célébrations du centenaire de la naissance de Georges Brassens. À cette occasion, il est renommé Roquerols en hommage au phare du rocher de Roquerols entre Sète et Balaruc-les-Bains, sur l'Étang de Thau où Georges Brassens aimait se rendre.
Long de 56 mètres, il restera amarré au quai d'Alger le temps de réaliser quelques travaux d'aménagements intérieurs et extérieurs avant de trouver son point d’attache permanent, quai du Maroc.