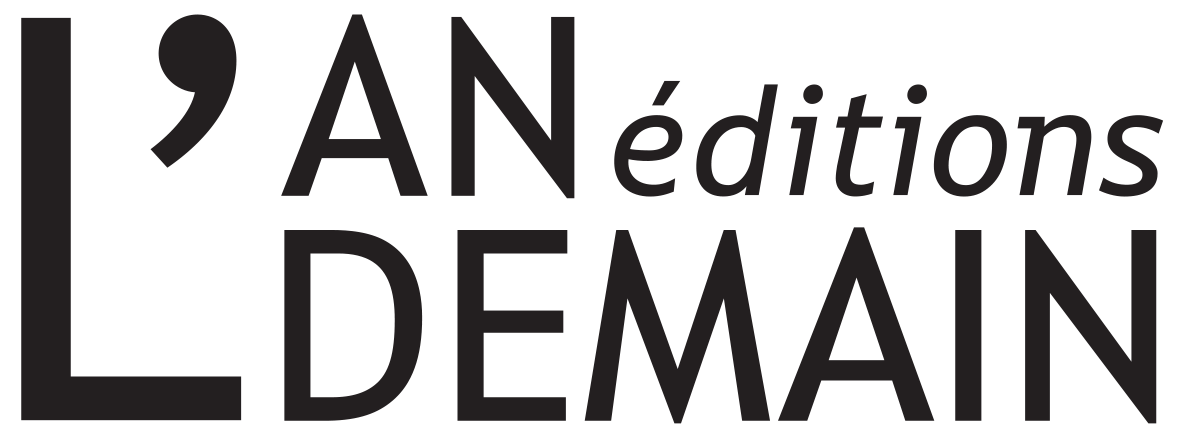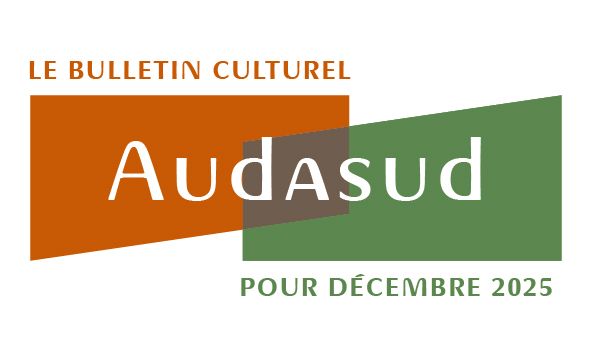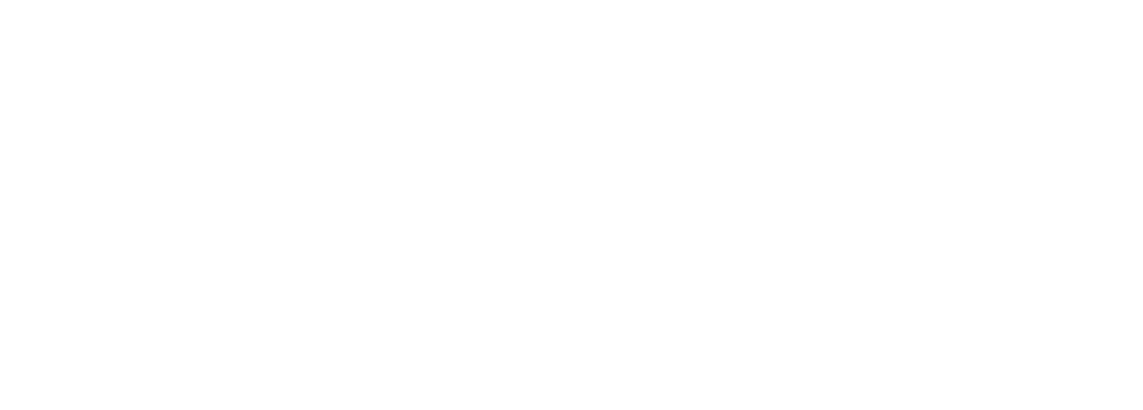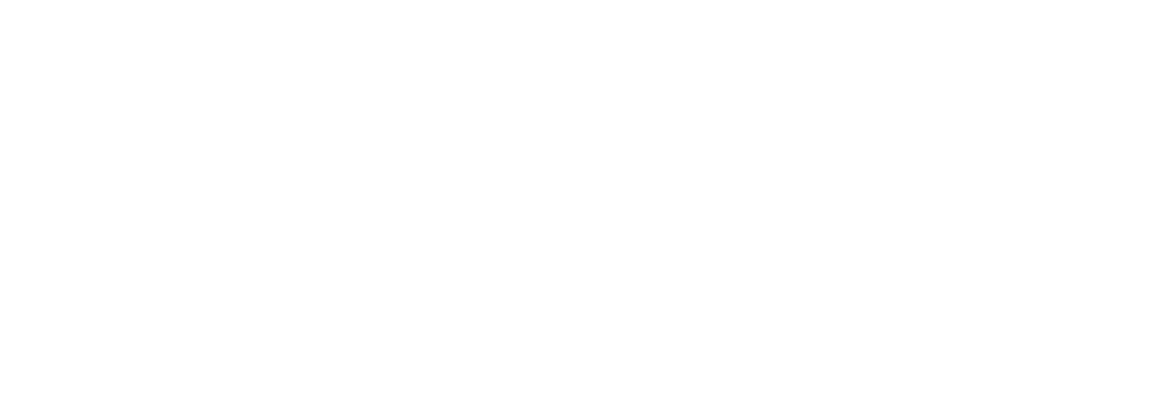C’est parés d’un sentiment de légitime allégresse, en ce jour anniversaire, que nous posons la deuxième pierre de cet humble édifice, en hommage à l’homme qu’il fut autant qu’au poète qu’il sera toujours. Georges Brassens, pour qui ne l’aurait pas deviné.
Dans une impasse Florimont qui fleure la misère, l’anarchiste calque ses jours sur la révolution de la Terre autour du soleil, levé dès potron-minet, couché avec les ténèbres. L’arche de Noé recueille les animaux sans compagnie, chiens errants, chats miteux, volatiles battant de l’aile. On y brûlait le pont pendant la guerre, mais dans ce cul-de-sac mal rapiécé, Georges Brassens a trouvé sa voie. La Jeanne, elle, illumine cette cité miséricordieuse. Gros bidon
— Brassens, avide de sobriquets, la surnomme ainsi pour sa manie de remplir sa bedaine des enfants de l’univers — Gros bidon, dis-je, avoue un penchant pour l’humanité. Marcel, son homme, pour la bouteille.
Elle accueille Jo depuis 1944, alors qu’il cherchait à faire rimer poète
avec cachette
dans l’ombre de la kommandantur. Il vivra plus de vingt ans au sein d’un ménage à trois. Son charme opère sur celle à qui on obtempère. Une vie de bohème hors du temps à dévorer les grands poètes et penseurs à défaut de remplir sa panse. Un matin, Brassens ouvre des persiennes martyrisées sur un Paris libéré. Peu avant, Jeanne avait perdu son frère, résistant arrêté par la Gestapo et décapité à la hache. Mourir pour des idées
lui sera dédié.
Jusqu’en 1952, Brassens broie notoirement du noir. Il écrit à Roger Toussenot, son ami philosophe anarchiste, alias Huon de la Saône
par référence à Nerval : « Il n’y a pas de malade à l’impasse, mais un neurasthénique, moi. Cette maladie de l’âme me charme. Je ne crois pas au revolver, cependant. Ni à la corde, ni au poison…
». Poèmes et romans se font rabrouer. Quant aux auditions, elles sont gentiment louées… aux gémonies.
Sa guitare aux cordes chevrotantes sous le bras, il cahin-cahote pétrifié par le trac, suant de caveaux en cabarets. L’interprète aurait préféré se faire grossiste de chansons pour détaillants vedettes, qu’il trouvait bien plus autorisés à écouler ses vers. Une ultime audition, le 24 janvier 1952, décrochée par ses copains sétois de Paris Match, Roger Thérond et Victor Laville, le fait rencontrer une sirène blonde à la voix rauque et élégante, Patachou.
Née Henriette Ragon trois ans avant lui, Patachou doit son sobriquet, non à Brassens, mais à une brève carrière de pâtissière en province et à son restaurant-pâtisserie-cabaret montmartrois. Son registre parigot gouailleur a d’abord fait le bonheur des bouges voisins sous le nom de Lady Patachou
avant que le sien devienne le cabaret incontournable de la nuit parisienne. Elle y coupait sans vergogne les cravates de célébrités ou anonymes et accrochait les trophées au plafond, laissant les circoncis du col suspendus à ses lèvres.
Le bizut se lance dans son audition sous le regard intrigué de Patachou. Quelques titres plus tard, elle est conquise et lui offre son public. Brassens lui suggère plutôt d’interpréter elle-même ses chansons. Le premier soir, elle se frotte à Brave Margot et aux Amoureux des bancs publics puis propose à son public grisé d’en découvrir l'auteur. Une guitare à deux pattes sort du rideau chancelante et entonne Le Gorille et P. de toi, que la mieux embouchée Patachou ne pouvait interpréter.
La dernière note envolée, le public, jusqu’ici rompu aux chansonnettes, découvrait un cactus en fleur sous une peau d’auroch, assénant à langue raccourcie des diatribes d’un autre temps. Aussi intimidant qu’intimidé, Brassens depuis lors attise la curiosité. Le directeur du théâtre des Trois baudets, Jacques Canetti, invité à venir l’écouter, le trouve épatant et va exhorter à toutes jambes la firme phonographique Philips de faire signer au pornographe un contrat en or massif.
Affligé de voir un Brassens aussi mal à l’aise sur scène, le contrebassiste dans l’orchestre du cabaret propose spontanément de l’accompagner. Le duo rondement amorcé, Pierre Nicolas ne se doute pas qu’il aura le dos de Brassens pour horizon pendant plus de trente ans. Coïncidence notoire, il est né à l’endroit même où loge Brassens, impasse Florimont. Il y vécut jusqu’à ses neuf ans, puis épousa la contrebasse un peu plus tard, après s’être enjuponné avec le violon. Né le 11 septembre 1921, Pierre Nicolas poussera l’accompagnement outre-tombe, avec la célébration du centenaire de deux fidèles musiciens, à quelques jours d’intervalle.
L’enregistrement du Gorille et du Mauvais sujet repenti
au studio de la salle Pleyel fit tressaillir les techniciens plus habitués au swing de Claude Luter et Sidney Bechet qu’aux dandinements d’un gorille devant un juge. Neuf autres chansons sortiront sur disques 78 tours, dont Le parapluie
qui sera distingué par l’Académie Charles-Cros l’année suivante en obtenant le Grand Prix du disque 1954.
Le 6 avril 1952, Brassens fait son premier plateau télévisé à la RTF, la chaine de télévision nationale née trois ans auparavant. Les quelques 40 000 moniteurs à tube cathodique déployés en France cette année-là — soit moins de 1% des ménages — diffusent leur premier anarchiste dans des salons bourgeois terrorisés. Il haranguera par la suite sa Mauvaise Réputation devant le public de l’Alhambra. Puis il fait sa première tournée en France, en Suisse et en Belgique, avec Patachou et Les Frères Jacques.
À la veille de Noël de cette année fatidique 1952, neuf chansons sont gravées pour l’album Patachou chante Brassens
: La prière, Les amoureux des bancs publics, Brave Margot, J’ai rendez-vous avec vous, Maman papa
(interprétée en duo avec Brassens), La chasse aux papillons, Le bricoleur
(en exclusivité), Les croquants
et La légende de la nonne
de Victor Hugo. Les scènes voient leurs rampes faire feu de tout bois pour le troubadour qui désormais alterne les cabarets avec les tours de chant entre Bobino, l’Olympia et l’étranger.
Une question demeure avant de clore les années Patachou. Fâché de n’avoir pu la baptiser d’un sobriquet de son cru, Brassens l’appelait-il dans l’intimité par son prénom Henriette, ou plus court, par une Riette
dûment gazouillée ? La réponse appartient aux esgourdes accolées aux murs. On serait tenté de souscrire au diminutif manceau pour deux raisons. D’une part, avant lui, Rabelais faisait l’éloge de la riette qu’il nommait la « brune confiture de cochon ». D’autre part, chez les Brassens, la charcuterie tenait la dragée haute aux pâtisseries. Lesquelles n’avaient pas vraiment cours dans l’impasse.
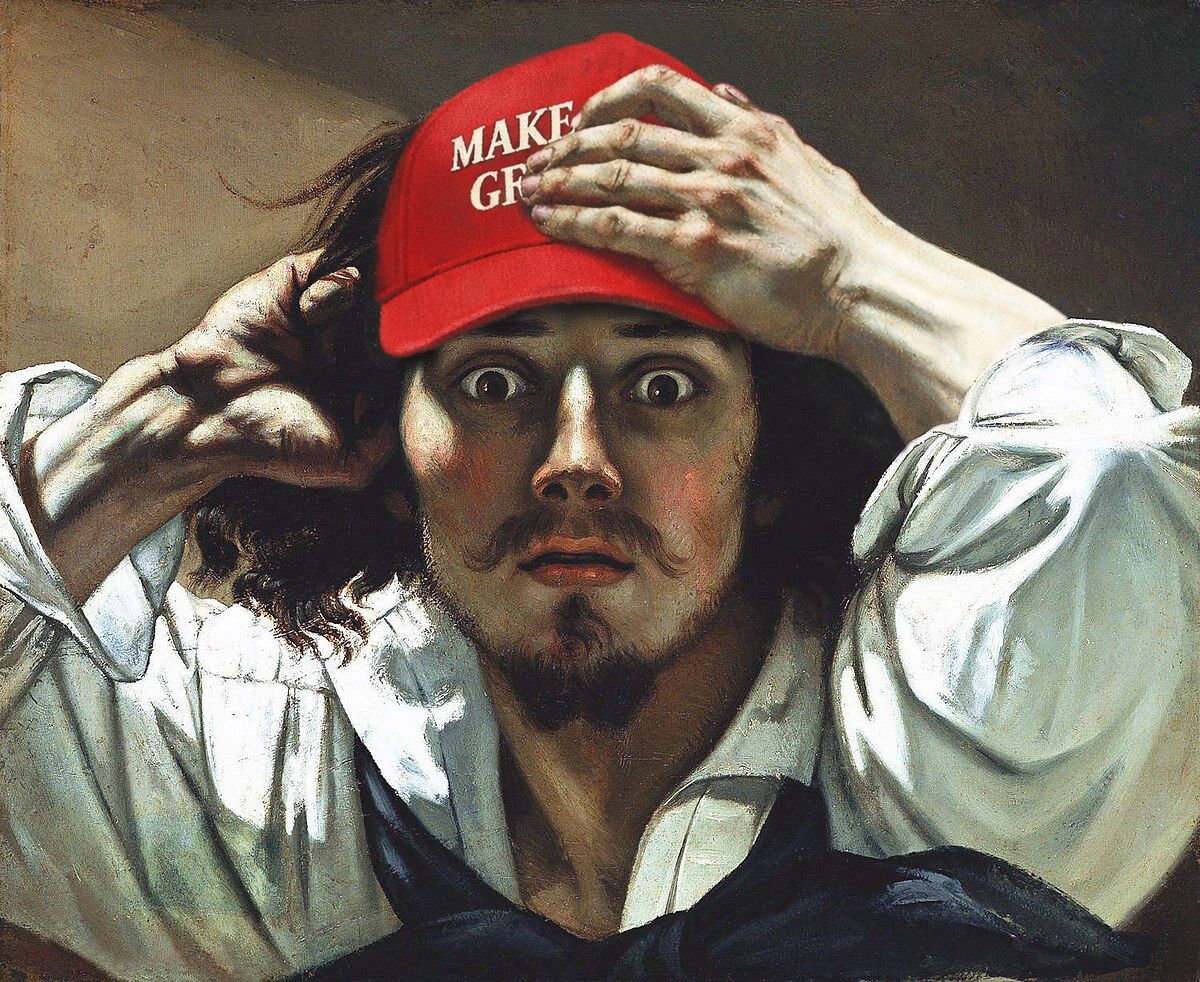
Le Désespéré résume fichtrement l’année culturelle écoulée. L’autoportrait de Gustave Courbet, peint dans sa jeunesse vers 1843, propriété privée depuis la mort de l’artiste, fut exfiltré en 2025 entre deux contrats mirobolants de la pétromonarchie et acquis en catimini par la sœur de l’émir du Qatar, surnommée la Culture Queen . C’est surtout, de notre patrimoine culturel, un portrait faisandé à s’en arracher les cheveux. Loin de ces dérèglements rythmés par des mortiers pétaradants à s’en péter les doigts, sur une île foutrement singulière, 25 Figures d’un même tonneau se massaient en… JANVIER au bar du Plateau comme le fera un nouveau contingent ce 24 janvier 2026, dans cet estaminet du Quartier Haut. Parmi ces FS3 qu’on espère présentes, une rameuse, un néo-crooner, un couple de tiellistes, un fossoyeur, un galérien, une fripeuse, des artistes évidemment… Un micro-festival animé par Laurent Cachard, écrivain-sismographe de la sociologie sétoise. Outre-atlantique, alors qu’un ancien président graciait quasiment tout ceux auxquels il a serré la main, un nouveau leader du monde libre, encadré d’Elon et ses Musketaires, prenait place dans son bureau ovale. À l’écoute du discours inaugural, les Groenlandais se découvrent une ressource stratégique sous leurs pieds emmitouflés : une glace qui produit près de 70 % des cas de gelures dans le monde. À propos de délogement… FÉVRIER voit l’Amadeus, ancien morutier copieusement centenaire, quitter l’angle du quai du Grand Pavois pour aller s’amarrer quai de la République. Le doyen des gréements sétois et son capitaine Jean-Christophe Causse y affichent la fierté des derniers témoins de la pêche à la morue, un patrimoine culinaire bien ancré dans notre île singulière. À Paris, un chahut parlementaire s’installe dans un hémicycle forcé de calfeutrer ses persiennes pour couvrir à la manière d’un fumigène les orgues de Staline de nos banlieues. Alors qu’à l’ombre de l’ancien palais consulaire, l’écrivain-philosophe Jean-Louis Cianni faisait revivre le Dernier rêve de René Descartes à la librairie Kailash et que s’éteignait la voix de The First Time Ever I Saw Your Face , en… MARS le label culturel Audasud montrait la face cachée de Ayerbe y Aragón , village et région ibériques, publié avec le talent acharné de l’archéologue et historien local Marc Lugand. Insatiable quand il s’agit de partager notre patrimoine culturel, Audasud livre à la Sehsser et à ses membres le Bulletin de la Sehsser 2024-2025 , dernier-né d’une collection forte de plus de 300 articles sur l’histoire de Sète et sa région. Toujours à Sète, un capitaine, aussi prompt à lever l'ancre que le coude, s’apprête à inaugurer, avec le même label, les Rencontres de l’Amadeus lors d’une conférence média, programmées à partir d’… AVRIL avec en ouverture le désespéré Arthur Roques, bagnard en Guyanne ressuscité par la voix plus qu’habitée de Simone Pons et par un dessin de presse qui annonce : pas besoin de gilets de sauvetage, ici on voyage sans bouger ! Au Plateau du Quartier Haut est servi, par les Rendez-vous des Automn’Halles, la romancière Cécile Gouy-Gilbert et sa Passion d’Arcélie . Une autre passion désespérée jette dans les rues de France cortèges et contre-cortèges dont on a oublié quelle étincelle mit le feu aux mortiers. Au-dessus de ce vacarme, une fusée plus pacifique, ayant décollé du Texas, mit sur orbite un équipage historique de six célébrités féminines pour une mission de… dix minutes. Depuis ce jour, les petites filles lèvent les yeux vers le ciel en rêvant de se fiancer à Jeff Bezos, à défaut de s’imaginer recevoir en… MAI un des prix du Concours de nouvelles 2024 organisé par les Automn’Halles à la médiathèque de Mèze. Plus de 140 candidats avaient répondu à l’appel du thème Grain de mer, grain de sable . L’Amadeus accueille une expo d’Itinérance Foto pour son festival d’artistes photographes, alors que le Festival de Cannes réunissait les fonctionnaires subventionnés du très très long métrage pour parfois parler cinéma. Là où il semble manquer de fonctionnaires, ce sont les tours de contrôle des aéroports qui, année après année, défraient la chronique et donnent de froides sueurs, avec des contrôleurs hors de contrôle, en congés Maldives ou autres lieux de villégiature. À Rome, Le nouveau pontife yankee, dont le nom officiel est Bob Ier, s’engage à canoniser l’équipe entière des White Sox de Chicago qui remporta les World Series, championnat de baseball, en octobre 2005, leur premier titre en 88 ans. Alors que Rodez célèbre à sa manière, en… JUIN l’année de la mer, à un jet de mortier de la Grande bleue. Une explosion de poésie dans l’antre du Grand noir, de souvenirs épars… la plage, les cabanes, les pêcheurs… disséminés façon intime en plus de 100 images et objets. « Je suis curieuse. Point. Je trouve tout très intéressant. La vraie vie. La fausse vie… » , nous dit Agnès Varda. À Sète, les Figures singulières s’affichent en grand et en duos sur les murs d’une médiathèque transformée en promenoir pour rencontres galantes. Pendant que la Maison des Pieds-Noirs se goinfre du grand méchoui annuel qui aurait fait se dresser sur la tête de BB sa célèbre gerbe de blé grisonnante, sept bombardiers furtifs américains B-2, opérant dans le plus grand secret, décollent d’une base toute aussi furtive et, lors d'une attaque surprise qui choque le monde, larguent 14 bombes anti-bunker sur l’Iran, que Trump accuse d’abriter des dossiers compromettants sur ses torrides escapades chez Jeffrey Epstein. Loin des jardins persans, celui de notre Château d’eau fait l’objet de toutes les attentions de notre quotidien régional, en… JUILLET sous le titre Parc Simone Veil : reflet de la culture sétoise . Une double-page nourrie entre autres d’une excursion du président de la Sehsser accompagné de deux jeunes journalistes pendant que se tramaient, en toute digression, deux limogeages à la tête de la société d’études historiques de Sète. Un putsch qui fait sortir de leurs gonds nombre d’adhérents et de son chantier naval les Gréements languedociens pour disperser en l’étang les cendres du Sehsserois Dominique Potié, pourfendeur de ce complot et initiateur de l’éphémère atelier de généalogie, au grand dam de ses participants. Tournant cette sombre page, Audasud inaugure, lors du festival Voix Vives, sa collection L’An Demain Poésie avec trois recueils : Texture 6, l’anthologie poétique 2025 , par les Amis de Michel Baglin, Carte de visite sétoise de Stéphanie Goué Quitté et Des Ans Parés de Lucile Latour. En pleines festivités de la Saint-Louis, à bord de l’Amadeus en… AOÛT Audasud présente Le Concours de pêche et son auteur Loris Chavanette. Perchée sur un bout de quai, une magnifique épopée fait naître les plus belles émotions, devant laquelle le grand Hemingway aurait certainement opiné du béret. Mais l'événement le plus marquant du mois d’août, si ce n'est de tous les temps, c'est l’annonce des fiançailles de Taylor Swift avec son futur époux, qui lui offre une bague de fiançailles considérée comme le premier bijou fabriqué par l'homme visible depuis l’espace. Ce qu’aurait pu observer un astronaute des odyssées Apollo, Jim Lovell, qui rejoint ce mois-ci les étoiles sans avoir pu marcher sur la Lune. Une infortune partagée par l’auteur de La Terre à la Lune . Jules Verne, l’un de nos plus grands écrivains, était à l’honneur en… SEPTEMBRE lors du Festival du livre de Sète, avec son arrière-petit-fils Jean Verne, présent pour célébrer les 150 ans de la parution de l’Île mystérieuse et lancer le concours de nouvelles 2025 dont la clôture des candidatures fut annoncée hier à minuit par les mortiers d’artifice ici, là et là-bas. Le centenaire de la disparition du grand compositeur Erik Satie fut l’occasion d’une ouverture des Automn’Halles animée par le pianiste concertiste Jean-Pierre Armengaud. Pendant les quatre jours qui suivirent, pas moins de 24 invités ont présenté et dédicacé leurs ouvrages. Parmi eux, deux Prix Goncourt : Pascale Roze en 1996, et un futur impétrant, Laurent Mauvignier, qui sera récompensé quelques semaines plus tard. Alors qu’à Paris tombait un nouveau gouvernement, sur la place du Pouffre, lors de la journée réservée aux plumes locales, Yves Marchand était venu dédicacer, au milieu des feuilles tombées des platanes, ses propres Feuilles Mortes publiées par L’An Demain. À quelques jets de fumigène de là, au Théâtre Molière, Patrick Joubert Annibal célébrait ses 60 ans de spectacle entouré des Frenchy Girls de Johanna et de l’orchestre de Didier Lévêque. À la fin du show, l’artiste dédicaça son épaisse autobiographie Lady Bee Story , publié par L’An Demain, qui à peine… OCTOBRE arrivé, allait présenter à toutes jambes au Plateau du quartier Haut Un monde sans Murat , écrit par Laurent Cachard, l’un de ses inconditionnels. À Paris, des monte-en-l’air, à l’aide d’un monte-charge et d’une disqueuse, dérobent en plein jour au musée du Louvre les joyaux de la Couronne de France. Le musée, bénéficiant du même niveau de sécurité qu'un distributeur automatique de boissons, embarrasse profondément ses responsables par ce vol effronté. Leur humiliation ne fait que s'aggraver lorsqu’ils découvrent une autre fuite, d’eau celle-là, endommageant gravement le manuel d’instructions de sécurité pour le bâtiment. Mais les gardiens était trop occupés à prendre des selfies devant les fenêtres du musée pour s’en apercevoir. Désespéré, l’État nomme un nouveau directeur de la sécurité du Louvre en la personne de François Bayrou, afin qu’il puisse bénéficier de quelques émoluments supplémentaires. À propos de grands commis de l’État, les Rendez-vous des Automn’Halles invitent en… NOVEMBRE Nous les Guilhems de Montpellier , l’histoire d’une grande dynastie montpelliéraine racontée sous la forme d’un roman par l’écrivain Didier Amouroux au Plateau du Quartier Haut. Novembre est un mois grave, on commémore le dixième anniversaire des attentats de 2015, on se recueille, on promet plus jamais ça, tout en constatant que ça est devenu plus fréquent. L’écrivain Boualem Sansal est gracié par le dey d’Alger après avoir goûté aux geôles barbaresques. Valentine Schlegel, elle, aurait eu 100 ans ce mois-ci. Un coin de quai transformé en placette porte désormais son nom. Elle vécut en famille dans l’immeuble qui lui fait face quand elle rencontra Agnès Varda avec qui elle vécut plus tard à Paris. Bien plus qu’une simple amitié à laquelle se limite pourtant la bienséance locale. Autre ambiance à Castries, où la communauté américaine célébra Thanksgiving dans le domaine de Fondespierre, qui offre une des plus belles balades le long de l’aqueduc construit par Paul Riquet en 1676. Tout aussi fascinante, une flânerie vous invite en… DÉCEMBRE à redécouvrir le Rugby du grand AS Béziers des années 1960-1984, un quart de siècle relaté et décortiqué par son indéboulonnable n°8, le Sétois Yvan Buonomo. Son livre, À la recherche du Rugby perdu , fait moins référence au temps de son pendant proustien, qu’aux légendaires troisièmes mi-temps biterroises. Yvan retrouva quelques-uns de ses anciens coéquipiers à l’occasion d’une dédicace de son livre publié par l’An Demain, une réédition augmentée de 40 photos historiques. Le temps de se remémorer, autour d’une bière ou deux, quelques matchs d’anthologie à la brasserie La Coupole, le siège d’avant-match des supporters à un jet de pétard de l’antre du Sauclières. À Sète, la médiathèque accueillait Patrick Joubert Annibal pour une présentation de son autobiographie Lady Bee Story , accompagné de son préfacier Éric Sarner, de son postfacier l’éditeur, et d’un clip vidéo de quelques minutes, condensé de son spectacle au Théâtre Molière. Le mois se terminait avec l’exposition-dédicace Voyage en Haut Aragon avec Topolino à l’Espace Félix, un recueil du dessinateur agrémenté de textes de Marc Lugand en français et en espagnol. Ainsi s’achève l’année 2025 avec la disparition d’une icône du cinéma et de la cause animale, assignée à résidence tropézienne pour avoir hébergé une poupée hypersexualisée et pour être… trop française. Les vœux présidentiels prononcés du bout des lèvres, auxquelles étaient suspendus une poignée de téléspectateurs, finissent de nous anesthésier. À écouter d’une oreille distraite l’Astrologue en chef, ils ont pu apprendre que les enfants qui naîtront au cours de cette nouvelle année seront dodus et radieux. Doués pour la reproduction, ils feront remonter la courbe des naissances. Plus tard, ils feront baisser celle de la dette et ne manqueront pas d’exceller à saigner un peu plus le peuple, remplaçant au fur et à mesure les petits hommes gris. Dans leurs bureaux haussmanniens, leur devise s’affichera en lettres d’or, au-dessus de leurs fauteuils capitonnés : Let’s boogie!

De l’obscurité des music-halls à l’obscurantisme des mollah, des Parapluies de Cherbourg aux machettes de boucher, des Tontons flingueurs aux massacreurs du Bataclan… il n’aura fallu qu’une soixantaine d’années. Les justaucorps jacquard et chapeaux melon ont fait place aux amples cafetans et coiffures d’imam qui peinent à cacher le sang d’un islamofrérisme rampant et son faux frère, l’islamo-gauchisme. Il y a quatre-vingts ans, la guerre, lassée de tant de vacarme, s’en est allée finir ailleurs. Les ondes radiophoniques, jusque-là traumatisées par les sirènes, reprennent du service : elles décident de diffuser autre chose que des alertes. Le 26 mai 1945 , on cherche un quatuor vocal pour mettre un peu de facétie. Quatre jeunes gens se présentent, aussi dégingandés qu’enthousiastes. On leur demande leur nom : ils n’en ont pas. — Appelez-nous les Frères Quelque Chose , proposent-ils avec modestie. Un technicien, homme d’un grand sens du hasard, s’écrie Les Frères Jacques ! Et l’affaire est faite, aussi vite qu’un jeu de mots en goguette. Le nom fleure bon la chanson enfantine et la plaisanterie potache, parfait pour faire les pitres avec gravité. Ils chantent, gesticulent, font le Jacques avec l’élégance d’un sémaphore en délire. Un soir, entre deux refrains et trois nœuds papillon, ils croisent Francis Blanche, qui leur écrit des textes où l’intelligence fait des claquettes. Leur premier répertoire ? Un buffet à volonté : folklore, negro spirituals, chants religieux, le tout saupoudré de synchronisation labiale approximative. En 1948 sort leur premier 78 tours, à une époque où la musique tournait plus lentement et durait plus longtemps. Le succès vient, trébuchant mais poli, et c’est Jacques Canetti qui, tel un bon génie en complet sombre, les propulse dans la lumière des projecteurs. Les voilà chantant sur des ondes enfin réconciliées avec l’humanité. Le 3 janvier 1982, un drame national — que dis-je, cosmique — s’est joué au Théâtre de l’Ouest parisien : les Frères Jacques ont décidé d’arrêter de chanter. Les âmes sensibles ont aussitôt crié au scandale, les autres ont continué à mâcher leur cacahuète, car c’était un dimanche. À la fin du spectacle, quatre chapeaux comiques ont salué le public avant de disparaître dans les coulisses. On raconte qu’ils se sont séparés pour vaquer à leurs occupations. J’en ai interrogé un : il comptait élever des silences en batterie. Un autre envisageait d’ouvrir un magasin de chaussettes pour mains, parce que les gants, c’est surfait . Pendant ce temps, leur pianiste Pierre Philippe, brave homme à doigts multiples, a décidé en 1995 de donner son dernier concert... à Saint-Bouize. Lieu prédestiné, car Saint-Bouize, comme son nom l’indique, est la capitale mondiale du soupir discret. En 1996, au Casino de Paris, on leur rend hommage. Cinq-mille spectateurs émus, pas une seule caméra. C’est dire si la télévision sait se tenir. Elle préfère filmer des débats sur la cuisson du flan plutôt que la gloire des artistes. Les années filent ensuite comme des croches sans mesure. Jean-Denis Malclès, tailleur en habits d’humour, quitte ce monde en 2002. François Soubeyran le suit de près, sans doute pour vérifier les coutures de ses ailes. Puis les frères Bellec s’en vont, l’un après l’autre, avec une ponctualité presque suisse. Paul Tourenne, fidèle jusqu’à la dernière note, s’éclipse en 2016 à Montréal — preuve que même les Jacques ont besoin d’un peu d’exil pour mourir tranquilles. Enfin, Hubert Degex, le dernier pianiste, rend les touches en 2021, à 92 ans, après avoir sans doute trouvé une partition d’éternité en ré majeur.
La Bibliothèque historique de la Ville de Paris conserve leurs chapeaux, leurs partitions et même leurs coupures de presse — tout ce qu’il faut pour organiser un sabbat érudit. Il ne manque que le son de leurs voix et le rire suspendu entre deux couplets. Leur répertoire, quant à lui, relève de la haute voltige intellectuelle : ils ont tout chanté, du général Castagnetas à la confiture , du Complexe de la truite (de Schubert) au derrière du peuple (voir La Digue du cul , œuvre d’intérêt public). Ils ont prouvé qu’on pouvait philosopher en collant des grimaces sur des vers de Prévert, et pleurer d’émotion tout en chantant des sottises. Ainsi s’achève cette chronique du souvenir. Les Frères Jacques ? Des poètes de velours à la boutonnière, des funambules du calembour, des anges qui savaient rimer avec dingue . Et s’ils nous entendent — là-haut, dans la stratosphère mélodique — qu’ils sachent une chose : le monde est bien triste depuis qu’il ne fait plus le Jacques.

Fin septembre, les Automn’Halles lanceront leur 16e édition. Seize années qu’un pari un peu fou a pris vie : celui de faire vibrer une île singulière au rythme des mots, de la lecture, de la musique et de la peinture. Depuis quatre ans, la reconnaissance officielle du Centre National du Livre est venue confirmer ce que les Sétois savaient déjà : que ce festival a gagné sa place dans le paysage littéraire national. Des partenaires fidèles — le réseau des Médiathèques de l’Agglo, le musée Paul Valéry, les librairies, le Plateau, l’Amadeus et désormais la Maison Régionale de la Mer — apportent leurs sites, leurs énergies. Grâce à eux, la littérature s’installe partout, elle respire dans chaque recoin de la ville, elle s’offre au plus grand nombre. Durant cinq jours, les auteurs se disperseront comme autant de semeurs de songes. Dans les classes, pour éveiller les élèves à la puissance des mots. Dans les espaces de rencontre, pour échanger directement avec leurs lecteurs. Dans les dédicaces, pour ce moment simple et rare où une phrase manuscrite scelle un souvenir. Le programme est riche, multiple, ouvert. Il accueille des figures déjà consacrées, et des voix nouvelles qui montent, prometteuses et fragiles. Il fait place aux auteurs et éditeurs locaux et régionaux, car la littérature vit aussi des racines qui nourrissent son terreau. Il tend la main aux talents en herbe, avec son Concours de nouvelles. Pendant cinq jours, Sète se transforme en une île de papier et de voix, où chaque rencontre devient une aventure, chaque lecture un voyage, chaque instant une célébration. Nous dédions cette édition des Automn’Halles à un auteur que nous avons accueilli au Crac en 2022. Boualem Sansal est emprisonné depuis plus de dix mois par un pouvoir totalitaire. Condamné pour exercice illégal de… sa liberté de penser et d’écrire. En appel de sa condamnation le 24 juin dernier, l’écrivain âgé et malade lâchait devant un tribunal de façade : « La Constitution garantit la liberté d’expression et de conscience et pourtant je suis là » . Yves Izard animait la rencontre avec l’auteur de Abraham ou La Cinquième Alliance paru aux Éditions Gallimard en 2020. En charge avec une équipe des Automn’Halles des relations avec les écrivains et les éditeurs, Yves va vous dire quelques mots sur cette rencontre à laquelle certains d’entre vous ont assistée. Boualem a dû laissé une belle empreinte dans vos mémoires. Les Automn’Halles… Ce pourrait être un titre-valise inventé par Erik Satie pour une de ses mystérieuses pièces musicales. On entendrait presque dans nos halles, haranguer : mercredi je peux pas, j’ai gymnopédie ! La question que vous êtes en droit de vous poser, c’est… qu’ont donc en commun Erik Satie et la littérature? Outre le fait qu’Alfred Satie, son père, fut un temps éditeur… Noble métier, s’il en est… Je répondrai qu’après tout, nous recevons samedi Hubert Haddad, l’auteur de… la Symphonie atlantique . Pour le clou de ce festival, car Il faut toujours un clou dans un festival qui se respecte, j’hésite entre… Laurent Mauvignier, l’aspirant au Goncourt, et Michel Zambrano, le sauveteur aux ondes courtes… Lequel nous lira des inédits vendredi à bord de l’Amadeus. Laurent Mauvignier, lui, nous fera l’inventaire de la Maison vide à la Maison de la Mer lors du premier grand entretien demain. L’inventaire d’une maison vide, ça devrait être court me direz-vous… Mais comme c’est Laurent Cachard qui se charge de l’animer, vous en aurez pour votre argent, même si l’entrée est gratuite. C’est simple, les Éditions de Minuit ne jurent que par Mauvignier et ne changeraient pas un traitre-mot de leur auteur fétiche. Je rapprocherais Erik Sati de… Jules Verne, dont nous accueillons samedi l’arrière-petit-fils, Jean Verne, pour les 150 ans de la parution de l’Île mystérieuse . Erik Satie prétendait faire de la musique d’ameublement, allant jusqu’à l’assimiler à du papier peint musical. De là à parler de papier peint littéraire il n’y a qu’un lai à tourner, un pas que des érudits franchissent à propos de Jules Verne. On objectera qu’il y a des papiers peints qui font voyager. Mais je préfère laisser les exzézettes , comme on dit ici, s’exprimer. Pianiste-concertiste international et musicologue, Jean-Pierre Armengaud est également l’auteur d’une colossale biographie du compositeur de Parade , que vous pouvez vous procurer ici ou à la librairie Gavaudan. Jean-Pierre Armengaud va nous rythmer cette rencontre par des illustrations musicales de Satie jouées au piano. À ses côtés, Patrice Legay animera cette soirée. Patrice est musicien et préside l’AMA Languedoc, l’association des Musiciens Amateurs du Languedoc. L’AMA Languedoc animera ici même demain de 10h à 12h une Master Classe de Jean-Pierre Armengaud avec des œuvres de Satie jouées au piano et chantées. Puis à la Médiathèque Mitterrand… le concert Erik Satie vendredi de 18h à 19h30 et la clôture des Automn’Halles dimanche à 18h, un Clin d’œil à Satie par le groupe de jazz Les Smiles. Je terminerai par un précepte que je fais mien : « Je ne me reconnais pas le droit d’abuser des instants de mes contemporains » disait le plus littéraire des compositeurs, celui qu’Alphonse Allais appelait Esoterik Satie. Merci et belles Automn’Halles à toutes et à tous ! Jean-Renaud Cuaz Président du Festival du Livre de Sète – Les Automn’Halles
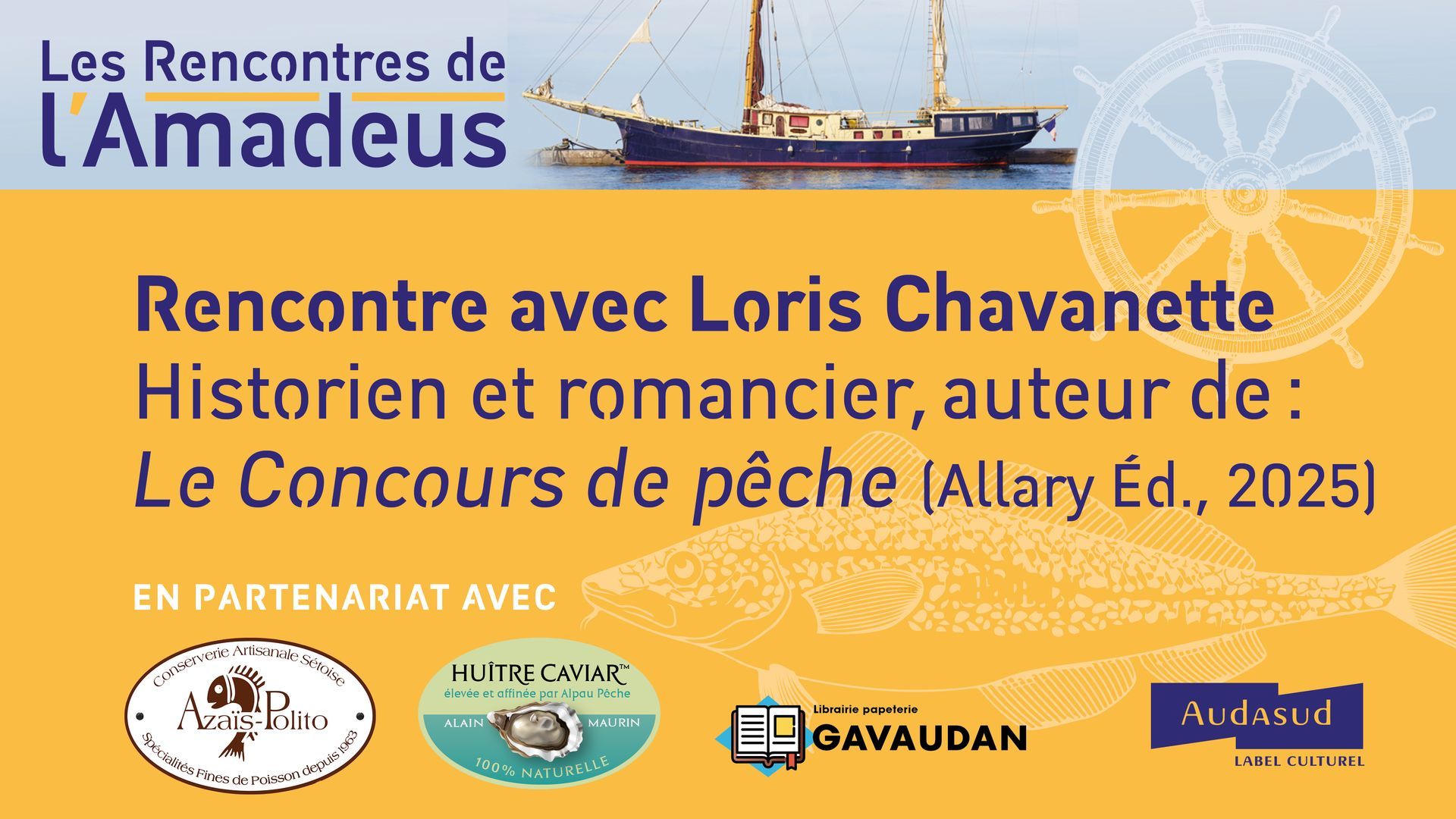
L’auteur ouvre son Concours de pêche en le dédiant à son ami Toto Neige, à l’origine de ce roman, ainsi qu’à tous ces clochards célestes sans lesquels il manquerait quelque chose au monde . Dans les premières pages, Alex, le narrateur nous invite à le suivre le long d’un quai avec son enfant Jonas qui découvre sous un palmier une dalle avec inscrit « ici a vécu Jonas le pêcheur ». Le Jonas que j’ai connu était l’homme le plus gentil du monde , lui dit-il. Je vais même te dire un secret, c’est grâce à lui si tu t’appelles Jonas . Il lui fait alors la promesse de lui raconter l’histoire de Jonas le pêcheur, plus tard, quand il sera plus grand. L’histoire d’un miracle . Mis sous pression par son boss , Alex croule sous un gros dossier, une de ces tours géantes qu’on aperçoit en atterrissant à Charles-de-Gaulle imaginées pour des gens qui y vivent. Son travail d’architecte c’est de faire en sorte qu’ils y restent le plus longtemps possible . La vie parisienne l’assomme, une vie au milieu de fantômes cravatés, les cernes tirés jusque là, éteints comme des cierges consumés . Un soir qu’il manque l’arrêt de sa station de métro et finit le trajet à pied, il surprend sa compagne à la terrasse d’un restaurant, dans les bras d’un autre, dont elle s’extirpe par un guttural « désolé Alex ! » . Il venait de casser sa tire-lire pour un gros diamant, décidé à lui faire sa demande dans le mois. Cinq années de vie commune partent en sucette et s’en vont valdinguer sur le trottoir. Il reconnaît pourtant qu’elle l’a libéré d’un cachot où il s’était enfermé lui-même à double-tour, en jetant la clé par la fenêtre . Un coup de pouce du destin qui le fera plonger dans l’alcool et enjamber son balcon d’où il tombera… du bon côté. jusqu’à trouver la rédemption auprès d’un réconfort maternel et d’un miroir qui renvoie l’image hirsute d’ un drôle de type . Un amour perdu peut mener à ça, une sorte de clandestinité vis-à-vis de soi-même . Et une résolution, avant que s’ouvre le chapitre paternel, Je vais voir la mer, là où est papa . La disparition du père, parti pêcher seul en mer, est l’occasion pour l’auteur, et pour Jack London, de nous rappeler, que l’on peut partir à la manière de Martin Eden, dans un océan de désespoir qui prend fin quelque part dans les abysses intimes et sourdes . La veille de son ultime sortie en mer, il avait emmené son fils pêcher au phare de Roquerols sur l’étang de Thau (…) Ses yeux étaient mouillés comme la coque d’un bateau flottant à la dérive . À Sète, en pleines festivités de la Saint-Louis, Alex revient loger sous un toit du quai d’Orient, avec sous les yeux le croisement des canaux et des ponts, et le douloureux rappel d’un lointain bonheur familial. À une encablure de là, à la terrasse animée du Barbu (devenu depuis quelques semaines le Bar Muge) Alex fait l’apprentissage auprès d’une autochtone de quelques leçons de savoir-vivre sétois, c’est-à-dire sans savoir-vivre du tout, sinon la gentillesse du cœur , qui, au réveil s’avèrent être tarifées. Plus tard et sans le vouloir, Alex le Parigot se retrouve au beau milieu d’une partie de pêche le long du canal , découvrant à la fois la scène et les acteurs d’une comédie dramatique à la sétoise. Il aura beau faire valoir une naissance des plus locales, Auguste et ses comparses le traiteront comme il se doit en île singulière, un estranger , trahi par le manque d’accent d’ici-bas. À force d’invectives et de fanfaronnades, voilà Auguste qui met au défi le plus vieux d’entre eux, surnommé le Turc , d’accrocher une dorade royale de 5 kilos, pas un de moins, prenant le quai de la République et ses flâneurs à témoins. Le Concours est lancé. L’Ancien sortira de sa torpeur pour une ultime bravade. Pour son Concours de pêche , Loris Chavanette en appelle à l’auteur du Vieil homme et la mer , autant que du vieil homme et l’amertume, ce fil discret comme un goût salé qui persiste et révèle des valeurs hemingwayennes : La perte et la privation . Alex vit avec une blessure d’enfance qui ne s’est jamais refermée : la disparition en mer de son père. Ce vide n’est pas seulement une douleur, c’est aussi une forme d’amertume envers le destin — un sentiment que la vie a triché, qu’elle lui a pris quelque chose de fondamental avant qu’il ait pu se construire. Cette aigreur se renforce au moment de la rupture amoureuse, comme une perte réveille les précédentes. Les affres du temps perdu. Le roman nous dépeint un homme qui, en revenant à Sète, mesure la distance entre ce qu’il aurait pu vivre et ce qu’il vit. Ce constat donne un ton désabusé, teinté d’une mélancolie que semble incarner Jonas l’Ancien, objet de toutes les attentions et de tous les superlatifs. Le concours, en apparence anodin, devient le théâtre de cette confrontation au temps qui passe — un temps qui n’a pas toujours été bien employé, ou qui a filé sans laisser de traces heureuses. L’âpreté des vies cabossées. Jonas, le sans-abri, incarne une autre forme d’amertume : celle des coups reçus par la vie et qui finissent par former une carapace. Derrière son pari du briquet en or, il y a sans doute des pertes, des humiliations, et la nostalgie d’un passé révolu. Ce personnage fait écho à Alex, comme un miroir de ce qu’il aurait pu devenir. Enfin, une amertume adoucie par la rencontre. Même si le roman laisse planer ce goût amer, il ne s’y enferme pas. Les dialogues colorés, les situations cocasses, la tendresse qui se noue entre Alex et Jonas viennent diluer cette sensation. On pourrait dire que le roman n’est pas une plongée dans l’amertume, mais une t entative de la transformer — comme si le sel de la mer pouvait devenir saveur plutôt que blessure. Le Concours de pêche Loris Chavanette Allary Éditions (21 août 2025) Loris Chavanette, historien et romancier, présentera son roman samedi 23 août à 11h, à bord de l’Amadeus, amarré, comme il se doit, quai de la République. Il est l’auteur de La Fantasia (Albin Michel, 2020), prix Méditerranée du premier roman.